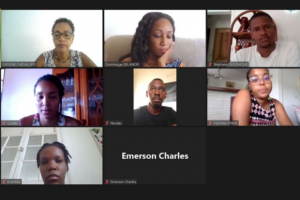L’équipe de France Volontaires au Sénégal s’est rendue au Laboratoire d’innovations sociales – le LABIS – de Dakar, un espace interactif à visée éducative et sociale. A l’initiative de Solidarité laïque, le LABIS permet aux jeunes dans une situation de précarité de développer des compétences.
Une partie de l’équipe de l’Espace Volontariats du Sénégal a profité de « la journée des droits des Femmes du LABIS », pour (re)visiter les locaux du LABIS de Dakar.
L’événement
Le communiqué du LABIS
« Les femmes et les hommes sont égaux, et les actions du LABIS s’inscrivent dans la parité hommes-femmes ; de plus, Solidarité Laïque dans le cadre de son programme Compétences pour Demain #CpD compte toucher 52% de femmes sur le nombre total des bénéficiaires.
Programme de la journée de 9h à 17h :
- Témoignage de jeunes femmes modèles du LABIS ;
- Speed-dating autour des stands d’exposition ;
- Animation ;
- Conférence sur le « Droit de la femme ».
Cette action est possible grâce au programme CPD de Solidarité Laïque, soutenu par l’Agence française de Développement (AFD). »
Participants
- France Volontaires : Stéphanie AMBIANA (Chargée d’appui développement de partenariats et communication) et Aminatou BERETE (Chargée de mission recensement – en stage)
- Solidarité Laïque : L’équipe Sénégal, ainsi que les jeunes volontaires du Labis de Dakar.
Une équipe de l’AFD était également présente pour effectuer une revue des projets menés par les LABIS de la région Afrique de l’Ouest.
Présence France Volontaires
France Volontaires, dans son nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance (COP), veut renforcer son rôle de plateforme. Afin d’être au plus près de ses membres, une participation à leurs activités fait partie des moyens à mettre en œuvre pour renforcer les liens. Il s’agit de connaitre les actions des membres, pour mieux en parler et amener des pistes de réflexion pour mieux les accompagner.
Le LABIS de Dakar ayant officiellement ouvert fin octobre 2021, cette visite permettait également de découvrir les activités menées.
Les activités du LABIS de Dakar
Formations à destination des jeunes
- Formations courtes (photographie, cartographie, infographie…)
- Formations et activités génératrices de revenues. Lors de la visite, deux formations étaient en cours :
- sur le maraîchage : les jeunes sont libres de récupérer la récolte, la vendre ou l’utiliser dans la cuisine du LABIS.
- sur l’aviculture : un poulailler a été ouvert. Il accueille actuellement la deuxième promotion d’une dizaine de jeunes se formant à l’aviculture. Ces derniers reçoivent des poussins qu’ils amènent à maturité pour pouvoir en tirer profit. Un GIE vient de se former pour continuer cette activité hors des locaux du LABIS, qui les accompagnera dans leurs démarches.
- Création d’une cuisine tenue par les jeunes qui peuvent vendre les repas. Le tarif est de 700Fcfa pour le plat du jour, ce qui reste encore accessible pour les locaux. Aussi, le caractère opérationnel de la cuisine et la présence de jeunes sénégalaises pour sa tenue renforce l’idée de mener une activité découverte (cuisine sénégalaise) au sein du Labis de Dakar, avec les volontaires français ou sous dispositif français.
Engagement citoyen
-
- Activités pour développer l’engagement citoyen des jeunes (ramassage d’ordures, distribution de kit de première nécessité lors des inondations dans la zone de travail…)
- Libre expression des jeunes : les jeunes fréquentant le LABIS sont encouragés à proposer des activités autour de l’engagement citoyen. Ils bénéficient de l’appui de l’équipe (financier et/ou technique) si l’activité est validée par la majorité (jeunes et Labis).
- Le LABIS possède ses propres volontaires. Il s’entoure d’une équipe de volontaires recrutés de manière continue. Elle est composée de jeunes issus de la banlieue de Dakar, qui signent un contrat d’engagement attestant de leur accord à participer/mener au moins une activité au LABIS dans le mois et être des ambassadeurs de ce tiers lieu. Les volontaires reçoivent une indemnité.
Une session d’information improvisée
Au vu du nombre de jeunes présents et avec l’appui de l’équipe de Solidarité Laïque, l’équipe de France Volontaires s’est rendue disponible pour échanger avec eux sur le volontariat. Une vingtaine de jeunes présents dans les locaux sont alors venus s’informer.
Un ensemble de dépliants a également été laissé à disposition sur les présentoirs du LABIS.
Rencontres informelles
2 structures accueillants des volontaires français (chantiers et bénévoles) ont été découvertes lors de conversations informelles. Il s’agit de : « Rêves » et « Alpha-Dev ». D’après le directeur de l’association Rêves, M. Moustapha COLY, d’autres structures de la zone Malika, Keur Massar et Yeumbeul (banlieue de Dakar) sont dans la même situation. Cette information permettra d’accentuer la qualité du recensement des Volontaires Internationaux d’Echanges et de Solidarité (VIES).
En savoir plus
Solidarité Laïque
Membre de France Volontaires, Solidarité Laïque est une association qui lutte contre les exclusions et améliore l’accès de toutes et tous à une éducation de qualité. Présente dans une vingtaine de pays, la structure place l’éducation comme clé d’émancipation individuelle, du développement social, culturel et économique.
LABIS Dakar
Le LABIS (Laboratoire d’innovations sociales) de Dakar est situé au Centre Départemental d’Education Populaire et Sportive (CDEPS) de Mbao. C’est un espace interactif à vision éducative et sociale. Par la formation pratique et l’inclusion numérique, il permet de stimuler et valoriser la créativité, les partages de pratiques et savoirs, ainsi que les initiatives portées par des jeunes.