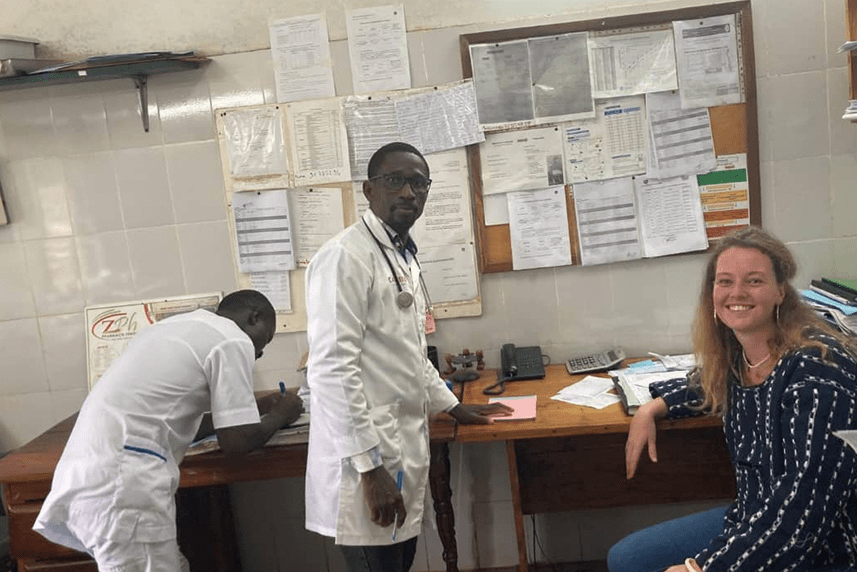Myriam Malo, “volontaire du progrès” au début des années 2000, a partagé son expérience avec des candidates au départ en volontariat lors d’une formation au départ courant juillet. © France Volontaires
Myriam Malo a fait partie des premiers volontaires de Guadeloupe partis en volontariat international en Guinée, en Afrique de l’Ouest. Déployée au début des années 2000 par l’Association Française des Volontaires du Progrès (l’ancien nom de France Volontaires), sa mission consistait à appuyer et orienter les autres volontaires du progrès (VP) tout au long de leur mission.
A l’occasion d’un stage de préparation au départ de volontaires, l’antenne de France Volontaires aux Antilles a accueilli Myriam Malo dans ses locaux afin d’animer l’un des modules de la formation. L’occasion pour cette ancienne « volontaire du progrès » (VP), comme on les appelait avant l’apparition du Volontariat de solidarité internationale en 2005, de témoigner auprès des nouveaux partants, et de partager son regard sur cette expérience, une vingtaine d’années après sa mission.
Les débuts en volontariat international en Guinée Conakry
« On nous appelait les VP et les VPettes », s’amuse d’emblée Myriam, face aux volontaires présentes pour l’occasion. Celle qui était alors en mission « Information et Formation » (VIF) durant trois ans explique sa démarche : « J’avais déjà quitté la Guadeloupe et j’accompagnais ceux pour qui c’était un premier départ ». Tout comme c’est le cas aujourd’hui, il y avait alors énormément de profils différents, des Bac + 3 aux ingénieurs.
Myriam, curieuse de tout et multi-casquettes avait contribué à différentes missions, découvrant des secteurs d’activités allant de « l’élevage à l’agriculture, en passant par la mise en place de coopératives, et même la prévention santé, sans oublier l’encadrement de volontaires au sein de leur nouvel univers ».
Pour Myriam, vivre à l’étranger, c’est vivre tout plus fort. Durant la mission, « On vit tout doublement, voire triplement. Il est important de prendre du recul et de faire le point sur soi. À l’étranger, hors de notre zone de confort, on est beaucoup plus vulnérable. On ne s’en rend pas compte, mais nos émotions sont décuplées, on les vit puissance deux. D’un côté, c’est très bien car on profite du moment présent, mais d’un autre côté, il faut savoir rester lucide sur les enjeux de notre présence, même si l’expérience est intense. On peut aussi avoir l’impression, poursuit-elle, que personne ne peut comprendre ce que l’on vit ou ce qu’on a vécu. »
«À l’étranger, hors de notre zone de confort, on est beaucoup plus vulnérable. On ne s’en rend pas compte, mais nos émotions sont décuplées, on les vit puissance deux. »
Myriam Malo, ancienne volontaire du progrès et désormais formatrice et animatrice à la radio.
C’est la raison pour laquelle elle incite les participantes à garder un contact régulier avec leur famille, des proches qui savent qui on est et peuvent parfois nous rappeler nous-mêmes. Néanmoins, pour Myriam, il faut aussi savoir faire la part des choses entre la réalité des faits et les clichés qui alimentent parfois la vision de ceux qui sont restés au pays.
Vivre son volontariat intensément et créer du lien avec la population
Pour Myriam, le secret d’un volontariat réussi tient autant dans l’ouverture aux autres que dans la simplicité des instants partagés. Même si le choc culturel n’a pas été aussi marqué qu’elle l’imaginait, les premiers jours ont eu leur lot d’inconforts. Une fois ces repères trouvés, elle s’est pleinement ouverte à son environnement : danser, pratiquer un sport local, apprendre la langue, observer la faune et la flore… « C’est en Guinée que j’ai découvert ce qu’était une buse ! » lance-t-elle en riant. Et de conclure : « Pour s’épanouir, il faut vivre la mission au-delà du cadre professionnel, en passant du temps avec les habitants. Ce sont ces moments simples, hors de toute obligation, qui créent des liens durables et font naître de vraies amitiés. »
Au fil de l’entretien, la conversation glisse vers la question de la valorisation de la mission et de la manière d’en garder une trace, pour soi comme pour les autres. L’expérience est, selon Myriam, si intense qu’elle peut sembler fugace, au risque de s’effacer avec le temps. D’où ses conseils : photographier, documenter, consigner. Elle recommande de tenir un carnet de bord en deux volets. L’un, personnel, pour revenir sur ses activités, ses choix, ses émotions ; l’autre, professionnel, pour consigner les tâches accomplies, les compétences acquises et les méthodes déployées dans un contexte souvent éloigné de sa zone de confort, avec peu de moyens mais des objectifs à atteindre. Plus qu’une simple chronologie, ce journal permet de mesurer les évolutions profondes, de suivre la manière dont le regard sur le monde se transforme au fil des mois, et d’exercer une réflexion sur son parcours.
Préparer le retour et valoriser son expérience de volontariat
Ce même carnet devient un appui précieux au moment du retour. Si le « choc culturel » à l’arrivée est bien identifié, celui du retour reste souvent sous-estimé, alors qu’il s’agit d’une étape déterminante. Myriam en sait quelque chose : après trois années de mission, il a fallu réapprendre à trouver sa place, se réinsérer dans le marché de l’emploi et faire reconnaître la valeur de l’expérience acquise. Malgré un master en information et communication et trois ans de terrain à l’international, la recherche d’un poste s’est révélée plus complexe que prévu. Entre le manque de reconnaissance de certains recruteurs et les évolutions du secteur depuis son départ, elle a dû revoir ses ambitions et élargir ses perspectives. Un événement familial l’a finalement ramenée en Guadeloupe, où elle s’est formée au métier de conseillère en insertion, spécialisée dans l’accompagnement à la formation et la levée des freins périphériques.
Les difficultés professionnelles surmontées, d’autres, plus personnelles, ont pris le relais. Myriam parle volontiers de ce « déphasage culturel » ou, plus simplement, du « choc du retour » : la nécessité d’accepter que, même si l’on retrouve son territoire, rien n’est tout à fait comme avant. Le système de valeurs évolue, les priorités changent. Retrouver sa place suppose de la patience, d’accepter le temps d’adaptation nécessaire et de rester attentif aux moments de flottement ou de découragement qui peuvent en découler.
« Avoir la liberté de partir est un luxe. Un séjour à l’étranger doit être alimenté par une profonde réflexion, une conscience de soi et de ce que cela implique en termes d’organisation personnelle. »
Aujourd’hui, Myriam ne se voit plus repartir. Elle garde un lien fort avec la Guinée et a envisagé d’y retourner, mais la vie quotidienne, les engagements pris et les contraintes financières ont eu raison du projet. Sa certitude est désormais inverse à celle qu’elle avait au moment de partir : sa place est ici. Elle dit aimer la diversité de son travail et y voir une continuité avec son désir initial de transmettre et de partager la joie de vivre. Forte de son parcours, elle insiste : un départ à l’international se prépare et se mûrit. Les motivations doivent être claires, réfléchies, et ne pas relever d’un simple besoin de changement. « Avoir la liberté de partir est un luxe, souligne-t-elle. Un séjour à l’étranger doit être alimenté par une profonde réflexion, une conscience de soi et de ce que cela implique en termes d’organisation personnelle. »
La question n’est pas tant de savoir s’il faut partir ou rester, conclut-elle, mais de comprendre pourquoi l’on souhaite partir.
Volontaires du progrès : l’esprit pionnier
Né en 1963 dans le sillage du Corps de la paix américain de John F. Kennedy, le statut de « volontaire du progrès » est lancé par le général de Gaulle et son ministre de la Coopération, Raymond Triboulet. Objectif : offrir à de jeunes Français la possibilité de partir soutenir des projets de développement aux quatre coins du monde. Reconnu et cofinancé par l’État, ce dispositif a marqué toute une génération d’engagés, sur des missions longues et exigeantes. En 2009, l’Association française des volontaires du progrès (AFVP) devient France Volontaires, pivot de la coordination et de la promotion du volontariat.

Myriam, lors de la formation au départ courant juillet. © France Volontaires
Bio express
Diplômée en info-communication à l’université de Villetaneuse, Myriam Malo est responsable pédagogique au sein d’un centre de formation des apprentis en Guadeloupe. Elle a été correspondante de France Volontaires en Guadeloupe pendant six ans, de 2010 à 2016. Elle a également effectué des déplacements en Haïti à la rencontre de volontaires et a accompagné des associations d’éducation populaire telles que les centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMÉA). Engagée dans l’association Kilti Kontré, en 2020, à la suite de la crise du Covid, elle a contribué à la mise en place de la web radio Radyo Kotkarayib.