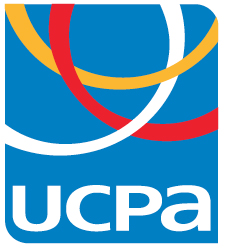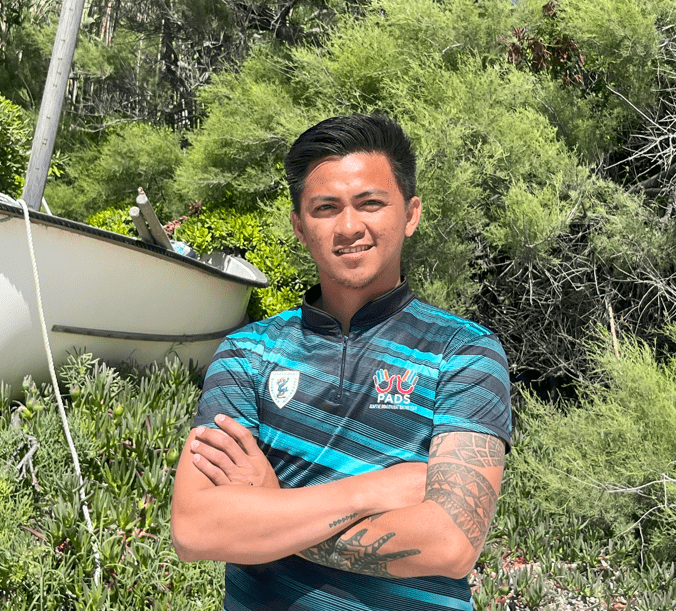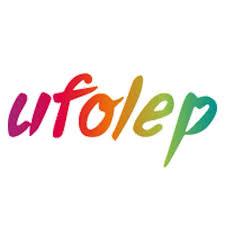© Sarah Cayre / France Volontaires
Le volontourisme, forme de tourisme mêlant voyage et engagement solidaire, séduit ceux en quête de sens et désireux d’aider. Derrière des intentions souvent louables, se cache un modèle marchand : des séjours payants proposés par des organisations qui tirent profit de l’engagement volontaire, parfois au détriment des communautés locales.
Pour Emma, l’envie de faire du volontariat en Afrique est venue en partie grâce aux réseaux sociaux. Mais dès son premier voyage au Togo à 19 ans, elle a vite déchanté : ni formée ni encadrée par l’organisme avec lequel elle était partie, elle a très mal vécu une mission à l’intérêt douteux pour les populations locales. Elle témoigne de cette mauvaise expérience de “volontourisme”.
Juste avant le départ
” Me sentant perdue et en quête de sens, j’ai décidé, comme beaucoup d’autres, de me lancer dans un « voyage humanitaire ». Ma sœur, qui a pris en charge toute l’organisation, m’a accompagnée dans cette aventure. Pour vous dire à quel point je n’étais pas impliquée, je ne savais même pas où se trouvait le Togo en Afrique.
Centrée sur mes propres soucis, je me suis laissée porter sans vraiment réfléchir. J’ai commis toutes les erreurs possibles : je n’ai pas pris le temps d’étudier le pays ni sa culture, j’ai choisi de travailler avec des enfants sans avoir ni les compétences ni la formation nécessaires, et j’étais émotionnellement indisponible pour affronter ce qui m’attendait.”
Volontourisme : ce que j'ai vécu pendant la mission
“Pendant cette expérience, je me suis vite rendu compte que je n’étais pas prête. J’avais constamment l’impression d’être une imposteuse, une sensation qui ne me quittait pas. Je pleurais chaque jour en découvrant les histoires de certaines personnes, surtout des enfants. Je n’avais ni la patience, ni la maturité, ni la présence d’esprit nécessaires pour m’occuper d’enfants. À 19 ans, sans compétences ni diplôme dans le secteur, j’étais complètement dépassée par la situation. Ma sensibilité était à fleur de peau, et personne ne m’avait préparée à cela.
Je n’avais reçu aucune formation ni consignes avant d’arriver. Physiquement, je n’étais pas non plus à la hauteur. Porter des briques de 25 kg pour construire une bibliothèque sous une chaleur écrasante de 40 degrés était bien au-delà de mes capacités. Rien n’était organisé à l’avance. Tout se faisait à la dernière minute, et en réalité, nous n’avions pas de travail structuré. Nous nous contentions de ranger et de nettoyer la salle de jeux, d’aider les maçons à porter des briques ou à défricher, de faire jouer les bébés qui n’allaient pas encore à l’école, de rendre visite à des familles, de distribuer le goûter aux enfants, et d’organiser des activités pour eux le week-end. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n’allait pas avec l’association.”
"L’association ne débloquait pas de fonds pour les enfants qui nécessitaient des soins de santé, alors que nous avions payé pour couvrir ces frais"
“Dès que nous essayions de contacter les dirigeants pour obtenir des réponses, c’était silence radio. Ils ne répondaient plus. Au fur et à mesure, je cherchais à discuter plus précisément avec les bénévoles qui étaient là depuis plus longtemps, pour savoir ce qu’ils pensaient réellement de l’organisation.
J’interrogeais aussi nos animateurs pour comprendre leur opinion sur leur employeur. Nous avons découvert qu’ils travaillaient 24 heures sur 24 et que leur salaire était dérisoire comparé au salaire moyen au Togo. Parfois, ils n’étaient même pas payés. Nous nous posions énormément de questions sur la différence entre ce qu’ils recevaient et ce que nous, les bénévoles, versions à l’association. Le plus troublant, c’était de constater que l’association ne débloquait pas de fonds pour les enfants qui nécessitaient des soins de santé, alors que nous avions payé pour couvrir ces frais, ainsi que pour leur scolarité. J’ai fini par me disputer violemment avec les dirigeants, frustrée par leur manque de transparence.
Je commençais aussi à comprendre que notre présence dérangeait certains parents. Beaucoup d’entre eux acceptaient notre aide simplement pour ne pas nous vexer, et cela me mettait de plus en plus mal à l’aise. Ce décalage entre nos intentions et la réalité m’a poussée à remettre en question tout ce que je faisais là. Mais c’est à mon retour en France que j’ai compris le concept de white savior* et de volontourisme.“
Après la mission, ouvrir les yeux sur le volontourisme
“Au Togo, j’étais avec six autres filles, dont Ana, qui était très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Elle avait documenté tout son voyage et recevait énormément de commentaires. Si la majorité étaient encourageants, une partie critiquait nos actions au Togo. Au début, nous ne comprenions pas ces reproches. Peut-être qu’au fond, nous ne voulions pas admettre que ce que nous faisions n’avait servi à rien et que nous avions, sans le vouloir, contribué à une forme de marchandisation de la pauvreté. Après des heures de discussions, parfois même des disputes, nous avons fini par reconnaître que nous étions tombées, sans le savoir, dans les filets du volontourisme.
Pourtant, cette expérience n’a pas été entièrement sans valeur. Nous étions toutes sensibles aux questions de justice sociale et avions tissé des liens avec le chef du village. Lors d’une dernière discussion dans son bureau, nous avions imaginé ensemble un projet visant à fournir un système d’assainissement durable aux habitants d’Assomé pour réduire le taux de paludisme. C’est ainsi qu’est née notre propre association, Akpel’eau, avec pour objectif de ne pas reproduire les erreurs que nous avions vécues. La construction des valeurs d’Akpel’eau a pris des mois. Une chose était sûre : nous allions sensibiliser les autres aux dangers du volontourisme tout en agissant pour la solidarité.”
* La notion de “sauveur blanc” désigne les actions mises en scène par une personne occidentale dans un pays défavorisé afin de se valoriser positivement.
Le volontourisme, qu'est ce que c'est ?
Bio express