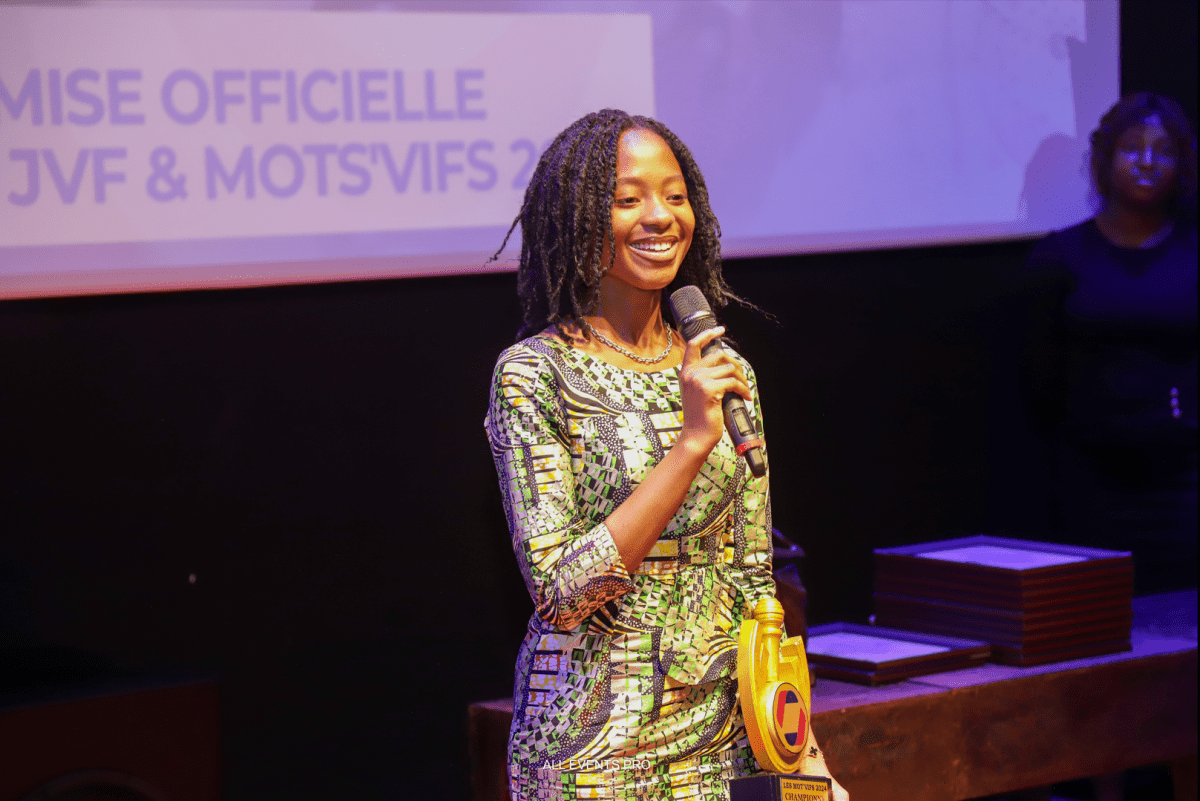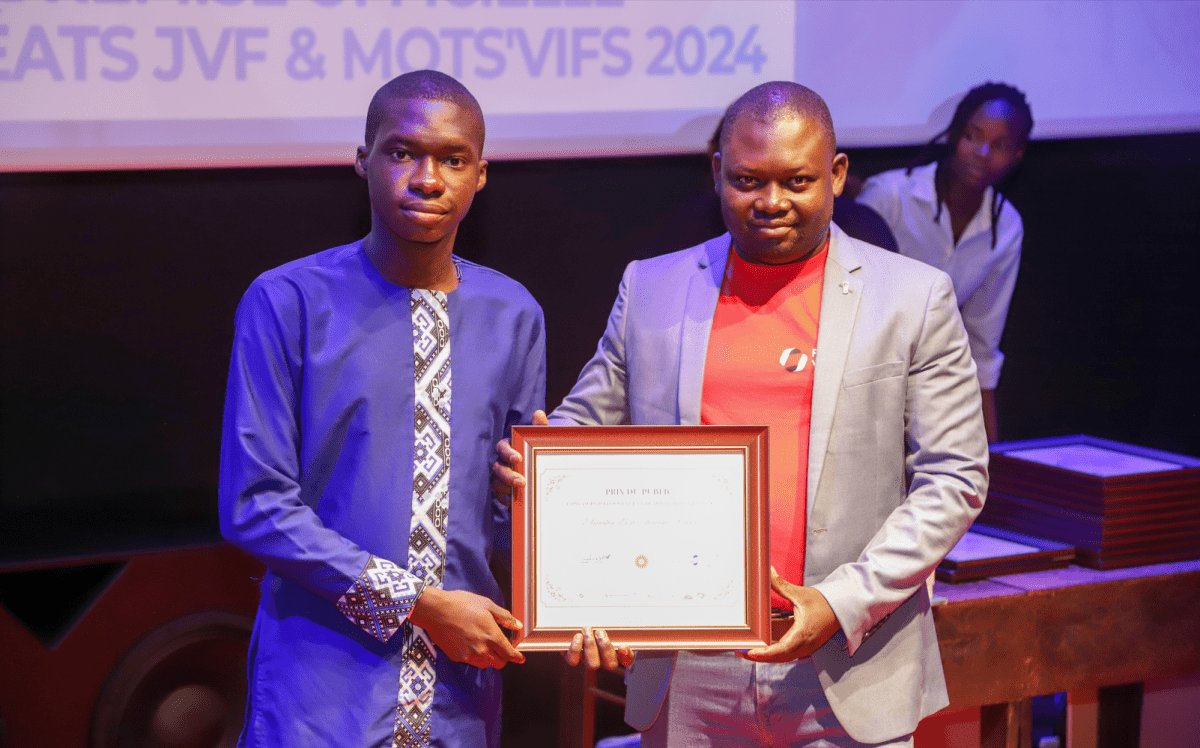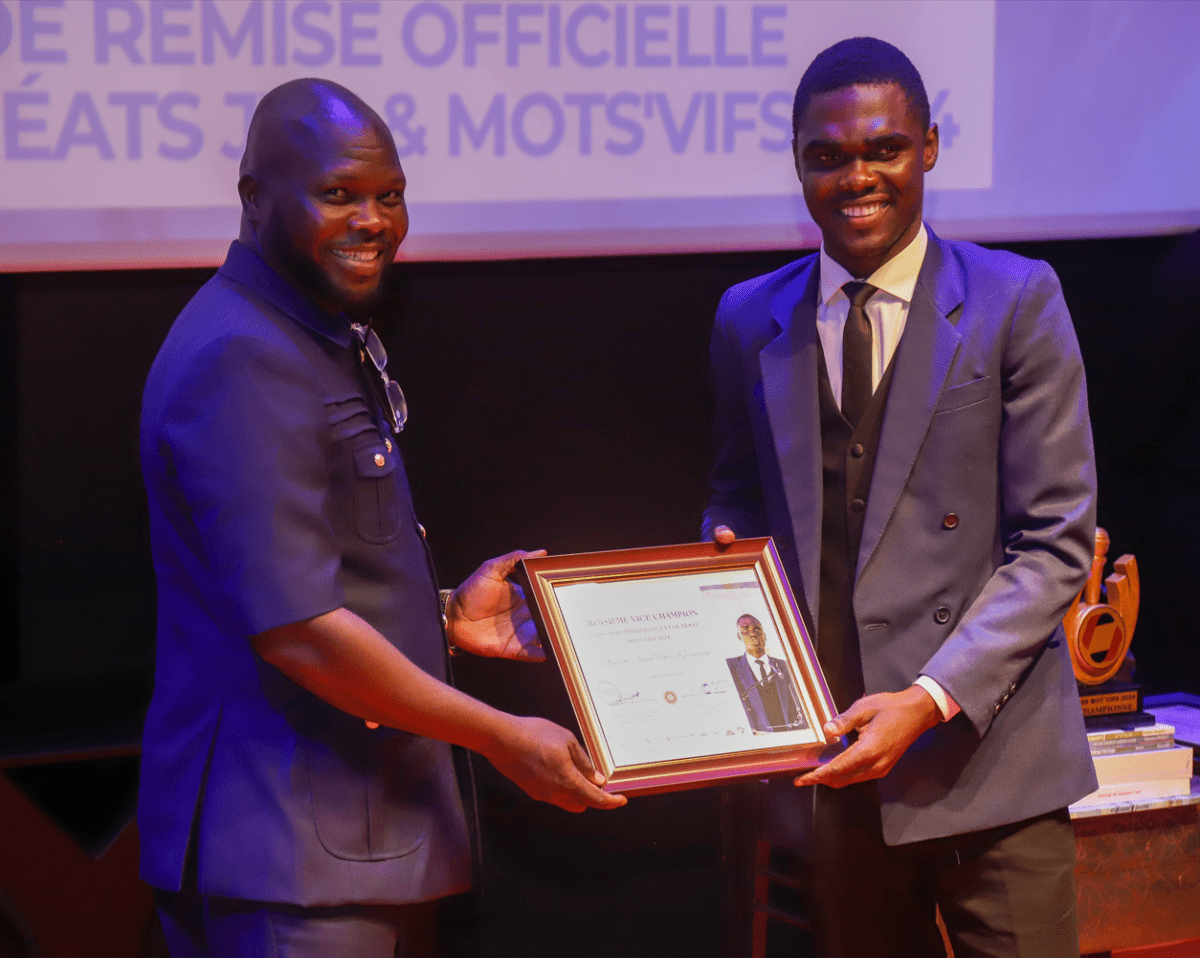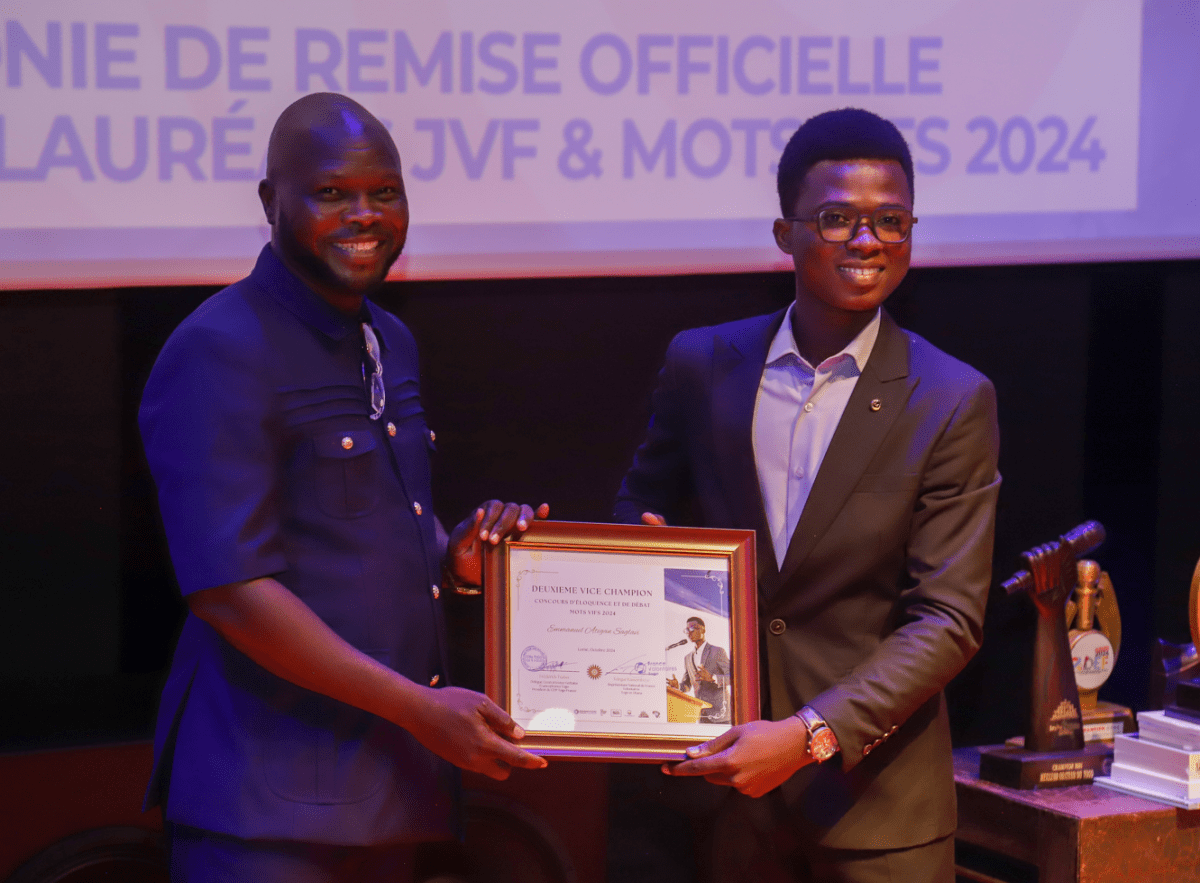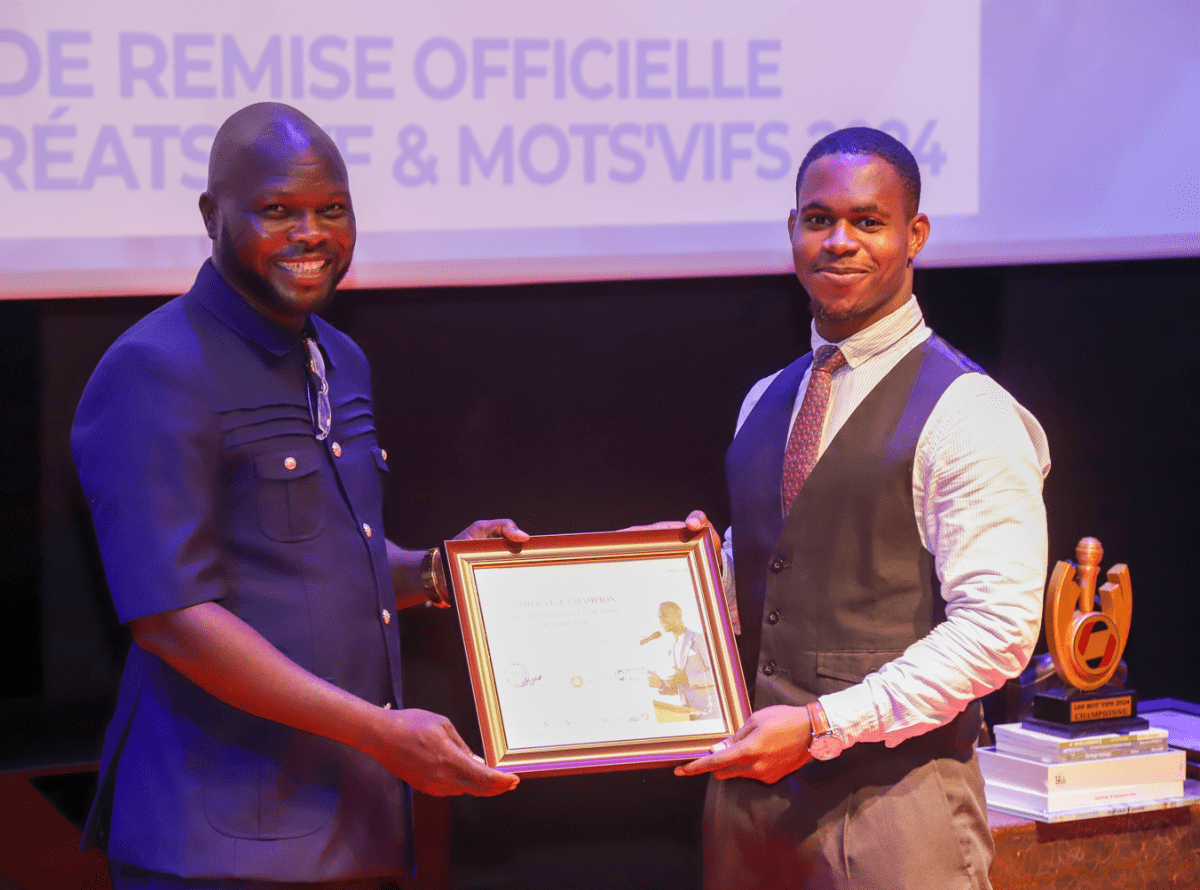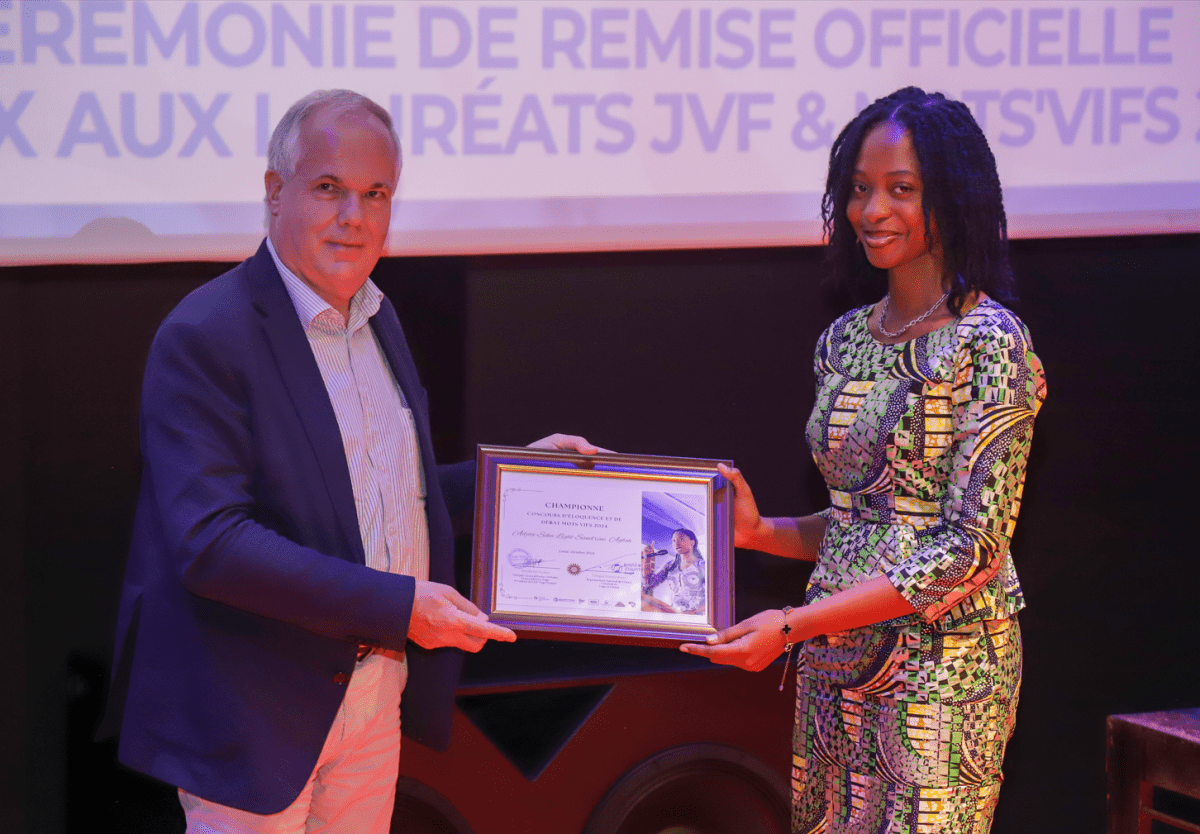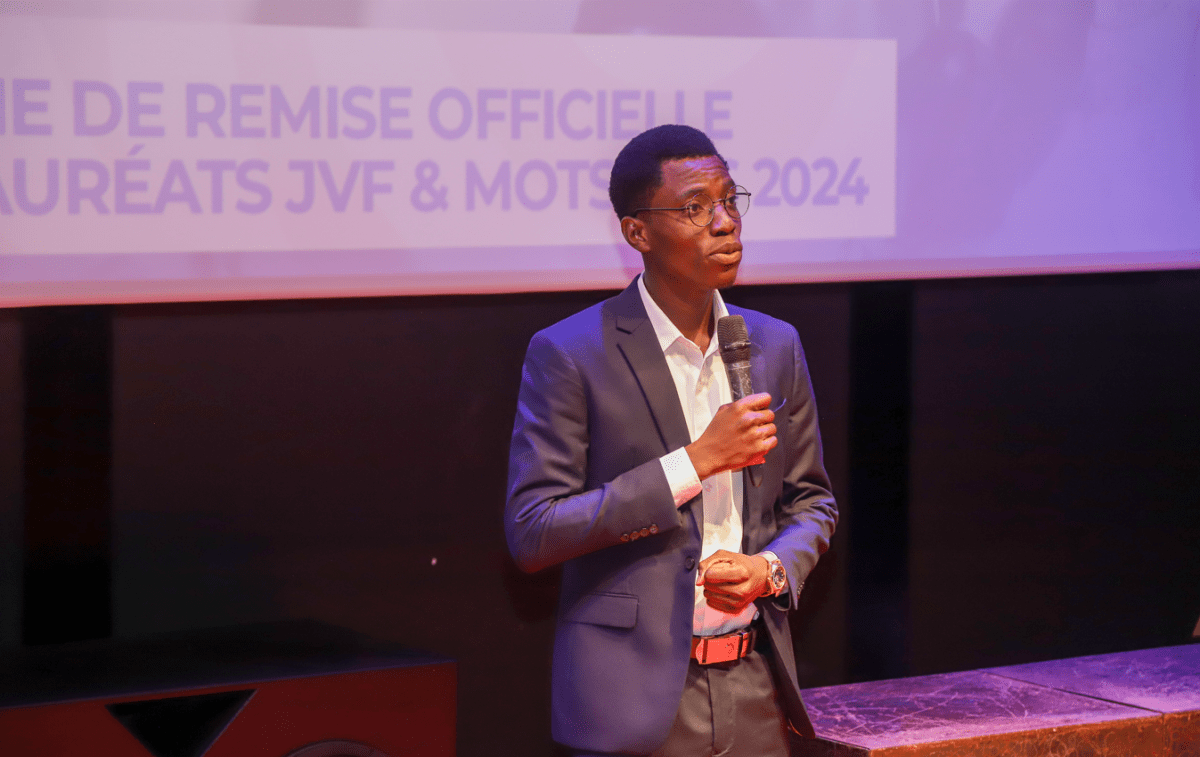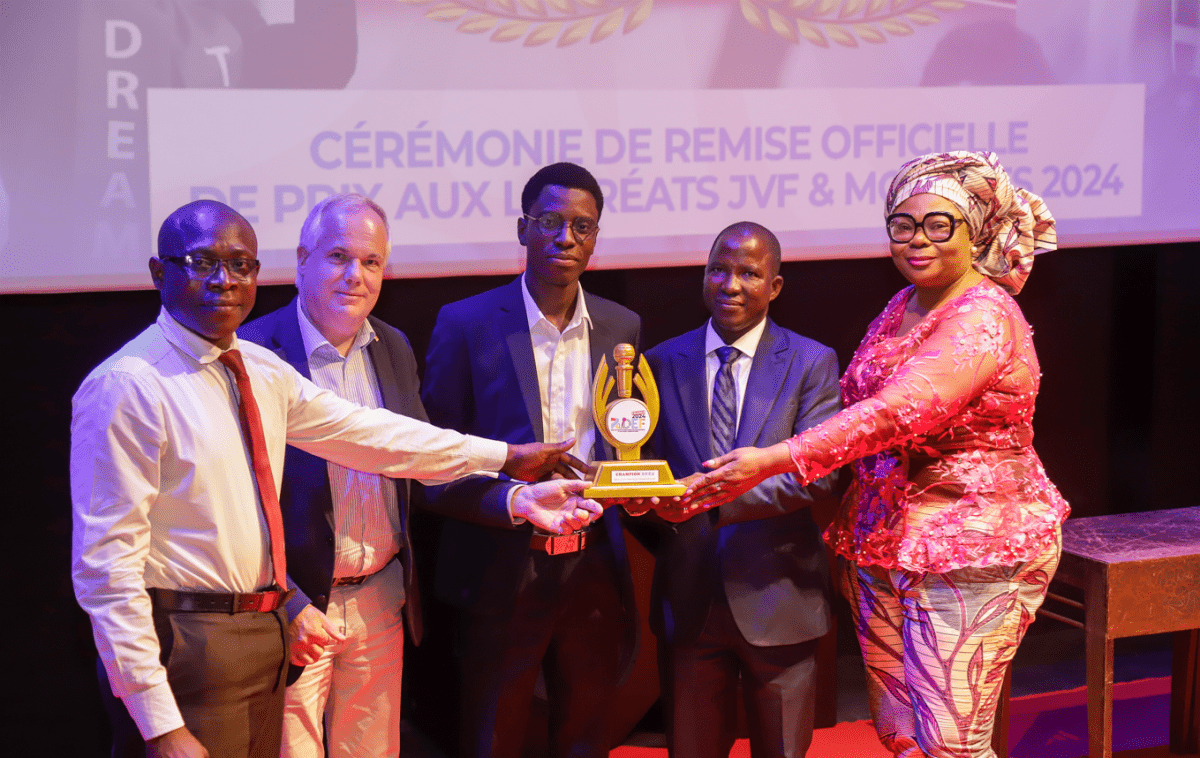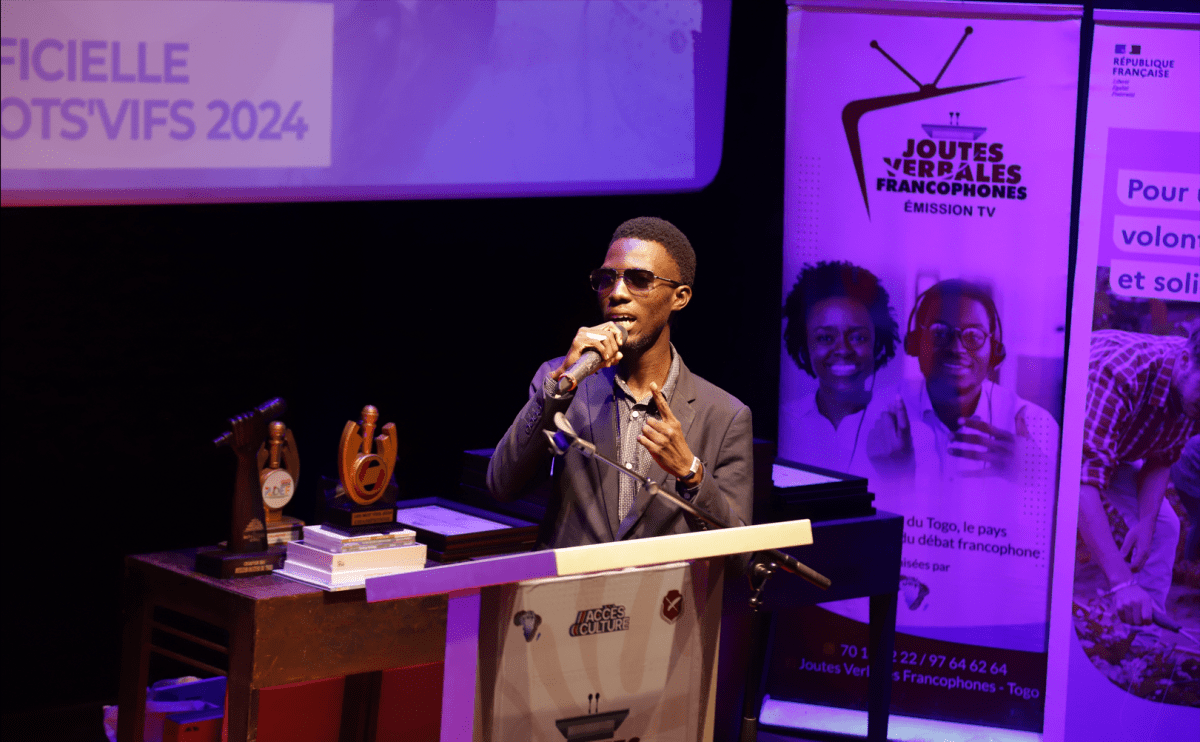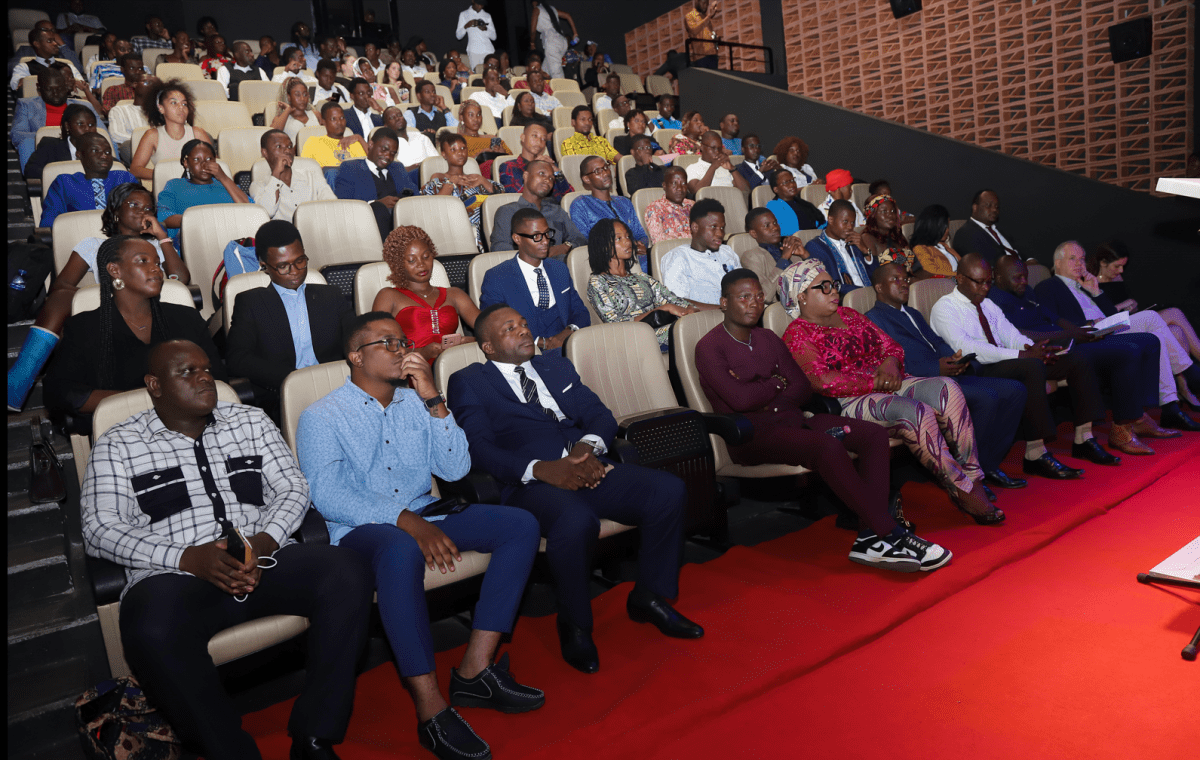« Vous avez un rôle moteur dans l’expression de cette énergie dont on a vraiment besoin pour construire un monde meilleur ! » : c’est par ces mots enthousiastes que Marie Barsacq, nommée fin décembre au poste de ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, a accueilli une vingtaine de jeunes, volontaires ou anciens volontaires, particulièrement ravis de participer à ce moment d’échange exceptionnel organisé au siège de France Volontaires, à Ivry-sur-Seine. Dans le cadre de sa visite, la ministre était accompagnée de Véronique Deprez Boudier, préfète déléguée à l’égalité des chances du Val-de-Marne, des élues Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne et Méhadée Bernard, adjointe au maire d’Ivry-sur-Seine, ainsi que de Nadia Bellaoui, présidente de l’Agence du Service civique, de Thibaud de Saint-Pol, délégué interministériel à la Jeunesse et enfin de Frédéric Cholé, délégué aux collectivités territoriales et à la société civile au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Engagement, olympisme et solidarité internationale
Composé pour moitié de Français revenus de leur mission à l’international (en volontariat de solidarité internationale ou en service civique) et pour moitié de jeunes ressortissants de pays partenaires qui réalisent une mission en France selon le principe de la réciprocité, ce panel de jeunes engagés a pu présenter à la ministre des propositions pour faire avancer le volontariat international d’échange et de solidarité (V.I.E.S), après que chacun eut évoqué son parcours personnel et ses attentes.

Basile Ouedraogo, volontaire en réciprocité, actuellement en mission à Nantes auprès de Solidarité laïque. © France Volontaires
« J’ai été témoin de l’incarnation des valeurs de l’olympisme lors de ma mission lors des JO. On a tous vécu une expérience réellement unique l’été dernier » a ainsi souligné Déthié Diaham, volontaire sénégalais dans le cadre du programme Terre de Jeux Paris 2024, en ouverture de la session d’échange. Sensible au sujet dans la mesure où elle a travaillé pendant plus de dix ans au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la ministre en a profité pour rebondir sur la question en évoquant les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à l’automne 2026 à Dakar (Sénégal), et qui seront également l’occasion de mobiliser des volontaires internationaux sur l’événement. « Ce sera une expérience incroyable, au-delà du sport, pour mettre en avant des enjeux de fraternité et de solidarité internationale », a-t-elle insisté, alors que Yann Delaunay, directeur général de France Volontaires, se rend justement au Sénégal dans les prochains jours dans le cadre de la préparation de l’événement. L’occasion pour ce dernier de rappeler que “depuis le début, le programme Terre de Jeux 2024 s’est construit en lien avec les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2026. France Volontaires travaille activement avec les autorités sénégalaises à la création d’espaces d’opportunité pour le volontariat autour de ces Jeux de la jeunesse, mais également au-delà dans tous les domaines où s’exprime la solidarité internationale.”
” Je pense qu’on a vraiment besoin de vous, les volontaires, pour apporter un regard différent, faire ce pas de côté pour nous challenger, nous qui sommes aux responsabilités. Je vous remercie pour cela, et je remercie France Volontaires de vous donner la parole.”
Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Le sport comme vecteur de développement était d’ailleurs l’un des fils rouges de cette matinée, plusieurs volontaires œuvrant dans ce secteur. Comme Julien Laborda, en service civique international au sein de l’association Malika Surf au Sénégal, qui permet à des jeunes femmes de découvrir le surf tout en étant accompagnée dans le cadre de leur scolarité : « Notre structure travaille autour des questions d’égalité de genre et nous mettons aussi en place des activités autour de la préservation et la sauvegarde de l’enfance en sensibilisant les équipes éducatives des écoles à ces questions », a ainsi détaillé le jeune homme.
Réciprocité et valorisation de l’expérience de volontariat
L’éducation a d’ailleurs constitué une autre des thématiques fortes de cette rencontre, justement organisée à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation du 24 janvier. « C’est le premier champ d’intervention des missions de solidarité internationale », a tenu à rappeler Yann Delaunay, « et le premier contingent de services civiques internationaux ».
Joseph Ha Thien Tru, qui a réalisé une mission comme coach en insertion professionnelle en Inde, a ainsi pu évoquer son expérience dans ce pays d’Asie où la précarité est parmi les plus fortes au monde, tandis qu’Eloïse Vincent soulignait pour sa part l’importance qu’avait eu sa mission pour de jeunes adultes du Timor oriental à qui elle a enseigné l’anglais.

© France Volontaires
À l’issue de ces échanges et d’un temps de questions-réponses entre la ministre et les volontaires, les volontaires ont pu porter des propositions concrètes autour de deux axes forts. Il a d’abord été souligné la nécessité de renforcer toujours plus le principe de réciprocité, qui permet à des volontaires internationaux de venir en France pour y exercer leur mission. « Ce principe que vous défendez permet de découvrir d’autres méthodes de travail, d’autres modes de fonctionnement et renforce l’interculturalité » a entendu la ministre, avant d’insister : « Vous pouvez compter sur moi pour continuer à le défendre ».
Par ailleurs, l’importance de la communication autour du V.I.E.S et de la valorisation de l’expérience acquise lors d’une mission ont fait l’unanimité : « Le volontariat en entreprise ou en administration ont une notoriété que n’a pas encore le V.I.E.S auprès des employeurs, cela manque pour valoriser le parcours des jeunes diplômés » a ainsi expliqué Juliette Briand, qui a effectué sa mission dans le cadre d’une académie de basket au Togo. Un message visiblement entendu par la ministre qui a ainsi conclu la séquence : « Je pense qu’on a vraiment besoin de vous pour apporter un regard différent, faire ce pas de côté pour nous challenger, nous qui sommes aux responsabilités. Je vous remercie pour cela, et je remercie France Volontaires de vous donner la parole. Votre voix compte et elle doit inspirer nos politiques publiques ».

De gauche à droite, Nadia Bellaoui, présidente de l’Agence du Service civique, Véronique Deprez Boudier, préfète déléguée à l’égalité des chances du Val-de-Marne, Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative et Yann Delaunay, directeur général de France Volontaires. © France Volontaires
Des membres de France Volontaires particulièrement mobilisés dans le cadre de cette visite
Un grand merci aux membres de France Volontaires et aux structures d’envoi, qui ont su mobiliser rapidement des volontaires pour cette superbe séquence : La Guilde, AIME ONG, Gescod, Fidesco, Life Project 4 Youth (LP4Y), Solidarité Laïque, Polaris Asso, Fédération sénégalaise de Badminton (FESBAD), Consortium national des jeunes, Anos.

Les vingt volontaires réunis autour de la ministre Marie Barsacq. © France Volontaires